

Ce lundi 19 avril après-midi, 365 hommes travaillent au fond de la mine relié au jour par deux puits voisins : le 11 (entrée d'air) et le 4 (retour d'air).
Vers 17 h 35, soudain une violente explosion.
Une flamme géante sortant du puits 11. Un nuage de poussières noires. La cage
supérieure, projetée à 20 mètres au-dessus du clichage, s'est incrustée dans le
chevalement ; les bâtiments annexes sont détruits, la maçonnerie du cuvelage est
disloquée. Les installations du jour sont ravagées. Une fumée épaisse, noirâtre,
monte vers le ciel. La terre a tremblé.

Les filles du triage. Les hommes. Que sont-ils devenus ? Au jour. Au fond de la mine. Combien de blessés, combien de morts ?
Au jour, trois jeunes trieuses de charbon affreusement brûlées sont dirigées sur l'hôpital Sainte-Barbe de Fouquières-lez-Lens.
Impossible de gagner le fond par le puits 11. Ni par le puits 4. Une cage y remontait : elle est coincée dans le guidage à 70 mètres de profondeur. Des hommes sont à bord.
Le spectre de la catastrophe de Courrières de 1906 apparaît une nouvelle fois. Vite, à la fosse 3 de Méricourt. Des équipes de volontaires se forment. Sous la direction de Leblond, délégué mineur de la fosse 4, et d'agents de maîtrise, elles gagnent les lieux de la catastrophe par des galeries souterraines ; personne ne songe un seul instant à la menace de mort qui pèse sur chacun : éboulements, nouvelles explosions. Les sauveteurs de l'équipe spéciale du poste central de secours de LIEVIN, alertés, arriveront un peu plus tard.
Des survivants avaient constaté l'impossibilité de remonter par le puits 4. Ils emmènent des blessés vers le puits de la fosse 3 distant de deux kilomètres. D'autres essayent d'éteindre des débuts d'incendie avec de l'argile, parfois mouillée d'urine. D'autres encore errent, traumatisés, hagards.
L'explosion a pulvérisé toutes les lampes aux abords des accrochages des puits 4 et 11. Une vision dantesque attend les sauveteurs. Des cadavres brûlent, prenant des formes démoniaques ; les blessés sont nus : la flamme a brûlé tous leurs vêtements, et atteint l'intérieur de leur corps. Des cris, des gémissements, des râles. Des chevaux sont momifiés. Le garde d'écurie est mort.
Le bruit de l'explosion, l'épaisse fumée qui s'échappe du puits et que l'on aperçoit de loin, le tremblement de terre, c'est pour la population de Sallaumines et des environs le présage d'une catastrophe dont la nouvelle se répand comme une traînée de poudre à travers les cités. Pour les familles des mineurs accourues en hâte, commence devant la grille de la fosse 4 d'abord, devant celle de la fosse 3 ensuite, une attente pénible qui se poursuivra tard dans la nuit : on était inquiet sur le sort d'une centaine de mineurs.
L'infirmerie de la fosse 3 est transformée en chapelle ardente. On attend, on espère à tout prix ; et, quand il n'y a plus d'espoir, quand on sait, cela devient atroce : l'identification d'un être cher, mutilé, défiguré.
Entre-temps, la circulation a été rétablie dans le puits 4 où les dégâts sont minimes. A l'intérieur de la cage débloquée, trois hommes : l'un gravement brûlé, l'autre légèrement blessé ; le troisième, sain et sauf, remonte par les échelles. Des sauveteurs descendent maintenant par ce puits.
Mardi matin, vers quatre heures, la remonte des corps est terminée. Deux jeunes filles, employées au triage, et un prisonnier de guerre allemand sont portés disparus. Pulvérisés peut-être par le souffle de l'explosion, la gerbe de feu. Dans la journée, au sommet du chevalement, une main calcinée est découverte.
12 morts, 35 blessés : tel semble être le tragique bilan de la catastrophe ; la centaine de mineurs, dont on avait craint qu'ils aient été ensevelis ou emmurés, étaient remontés vers minuit.
Commence alors une autre opération de sauvetage dans les hôpitaux des. anciennes compagnies des mines de Courrières et de Lens, celle des blessés : notamment à l'hôpital de Fouquières-lez-Lens. Sur les 30 blessés qui y sont soignés, 9 sont dans un état très grave.
Sous la direction du Docteur Delcourt, l'équipe de chirurgie locale composée des Docteurs Fiévez, Lugez et Masquelier, ainsi que le personnel médical, sont en permanence au chevet de ces brûlés vifs dont la vie est en danger. A 7 heures du matin, arrive de Paris, en voiture, le groupe de « réanimation-transfusion » de l'hôpital Foch amenant 150 ampoules d'un demi-litre de plasma sec américain. L'Institut Pasteur de Lille avait de son côté mis à la disposition des médecins six litres de plasma. Le conseiller médical des Charbonnages de France arrive dans l'après-midi avec 200 ampoules de plasma.
La salle où sont soignés les plus grands blessés est interdite au public. Au-dessus de chaque lit, des appareils compliqués, flacons, bouteilles d'oxygène que des caoutchoucs relient aux brûlés. Chirurgiens et personnel soignant opèrent, masque sur le visage.
Dans une autre salle, trois jeunes trieuses, les yeux clos, endormies par des calmants. Pauvres jeunes : les mains, les bras, les visages sont affreusement brûlés ; les chairs à vif, rouges de mercurochrome ; des taches de charbon sur le corps comme si le charbon avait brûlé sur leur peau.
Le corps médical tente l'impossible pour soulager, sauver ces hommes, ces femmes, meurtris dans. leur chair.
Un puits faisant effet de canon : une catastrophe jamais vue. Près des fosses, dans les cités, dans les cafés, on discute ferme.
On n'arroserait plus au pied de taille, ni au convoyeur, pour neutraliser les poussières. On tendrait à ne plus payer le balayage en taille des poussières de charbon. Economie ? Perte de temps ? Accroissement de la production aux dépens de la santé, de la vie des mineurs ?
Le délégué n'avait cessé de dénoncer le danger que représentait l'abondance des poussières dans la fosse 4. S'il n'y en avait pas, eu tant, il n'y aurait pas eu d'explosion, dit-on.
La catastrophe serait due à un « coup de poussier » ? Mais, pour provoquer l'explosion, il faut une flamme. L'orage qui se déchaîna sur la région dans la soirée de lundi a-t-il provoqué un court-circuit ? Un dépôt d'explosifs aurait-il sauté au fond ? Y a-t-il eu coup de grisou ?
Aujourd'hui, bon nombre de mineurs ne sont pas descendus. dans les fosses sinistrées. Mouvement de grève ? Non. Ils ont les bras « cassés », ils sont en deuil. Ils auraient pu être les victimes.
Au no 11 de la rue de Raismes, les volets sont clos. L'épouse du garde d'écurie pleure son mari. Pressentait-il la mort ? Avant de se rendre à la fosse, il était allé dire « au revoir » à ses sœurs ; il avait souhaité « bon courage » à sa femme. Ce qu'il ne faisait jamais ...
Dans une autre maison, 200 mètres plus loin, une mère et ses trois enfants. pleurent René QUINCHON, accrocheur. Le père de René et le frère de cette veuve sont morts dans la catastrophe de Courrières . . ., le père à peu près au même endroit que le fils.
Rue Edouard-Vaillant, il était parti travailler avec sa sœur ; lui avait 20 ans : il est mort ; quant à sa sœur, elle est à l'hôpital, grièvement brûlée ...
SALLAUMINES est en deuil...
Pendant ce temps, dans la fosse sinistrée, on constate les dégâts, on récapitule, on cherche à comprendre.
Aux différents étages les effets de l'explosion se sont faits sentir au voisinage du puits 11 et dans les bowettes, à moins de 300 mètres.
A l'étage 403, les dégâts matériels sont très importants. Les arrêts-barrages ou planches Taffanels, proches du puits, ont été balayés par l'explosion ; les arrêts-barrages suivants, distants de 250 mètres du puits, sont restés intacts. Plusieurs mineurs y ont été tués ou blessés. Dans l'écurie, à peu près intacte, 7 chevaux sur 12 ont été tués.
A l'étage 341, les effets de l'explosion se sont faits moins sentir. Le seul homme présent a été blessé par brûlures ; des chevaux ont été tués ; des arrêts-barrages voisins du puits ont fonctionné ; les autres, non.
A l'étage 289, les effets sont encore moins marqués qu'à l'étage 341. Personne ne s'y trouvait au moment de l'explosion, mais un dépôt de bois a pris feu quelques heures après l'explosion.
Grâce aux arrêts-barrages qui ont empêché la propagation des conséquences de l'explosion dans les galeries souterraines, la catastrophe n'a heureusement pas eu des conséquences humaines aussi dramatiques qu'en 1906. De plus, à la suite de l'explosion, les portes d'aérage qui séparaient les puits 4 et 11 furent détruites ; un court-circuit provoqua l'arrêt du ventilateur du puits 4 ; ainsi l'oxyde de carbone résultant de l'explosion s'évacua naturellement par les puits et ne passa pas dans les travaux du fond où il aurait causé un certain nombre de victimes.
Le mardi se passe sans qu'on ait retrouvé les trois disparus. Gertrude était le « Rossignol » de son quartier ; son père travaillait à la même fosse ; ses parents pourront-ils la revoir une dernière fois et pleurer sur son cercueil ? Hélène est également la fille d'un mineur qui travaille à la fosse 23 ; à quelqu'un qui le matin lui parlait des dangers de la mine, il avait répondu qu'en 20 ans de présence il n'avait connu la moindre égratignure. Les Allemands, du camp de Méricourt ont écrit à la famille d'Hermann Gueuer pour annoncer sa mort.
Dans l'après-midi, un blessé succombe à ses brûlures René Vasseur, de Sallaumines, accrocheur.
Des personnalités se sont rendues sur les lieux de la catastrophe.
En premier lieu, peut-être, Maurice Thorez, ancien mineur, secrétaire général du Parti Communiste, accouru dès l'annonce de la catastrophe et qui passa une partie de la nuit à la fosse 4 au milieu des mineurs, en compagnie de Jeannette Vermeersch. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Robert Lacoste, arrivé le matin. Le ministre des P.T.T., Eugène Thomas. Les autorités régionales et locales, les représentants des syndicats et autres mouvements. Tous venus s'incliner devant les corps des victimes.
Le soir, à la fosse, une affiche est apposée : « Le siège 4 étant dans l'impossibilité de marcher, les ouvriers sont considérés jusqu'à nouvel ordre comme en congé payé », alors qu'une délégation de mineurs avait eu l'assurance que la question serait posée au gouvernement. On n'avait jamais vu cela, même au « temps féroce » des anciennes compagnies privées. Le ministre de l'industrie sortait d'une entrevue ; il est sifflé, hué.
En vue de l'organisation des funérailles, le sous-préfet de Béthune, le Président du Conseil d'Administration des H.B.N.P.C. et les représentants des trois organisations syndicales C.G.T., C.F.T.C. et C.G.T. - Force Ouvrière, sont convoqués le mercredi matin à 8 heures aux Grands Bureaux de Billy-Montigny, siège de la direction du Groupe d'Hénin-Liétard.
Dès leur entrée, les délégués cégétistes s'élèvent contre la présence des représentants F.O. La C.G.T. prétend être seule qualifiée, avec les représentants de la C.F.T.C., pour prononcer les discours. F.O. réplique : la catastrophe doit éliminer les divergences syndicales ; cette organisation est la première à s'inquiéter des conditions de travail et de sécurité des mineurs alors que d'autres, à la suite d'un discours de Maurice Thorez à Waziers, préconisent la production à outrance et par tous les moyens.
Les représentants de la C.G.T. expulsent de la salle ceux de F.O. dont l'un des membres est blessé. Un incident grave.
Sur la place de la Mairie de Sallaumines, un monument en souvenir de la catastrophe de Courrières qui fit en 1906 près de 1 100 victimes.
Jeudi 22 avril, 42 ans plus tard, dans l'après-midi ensoleillé, se déroulent les funérailles des victimes de la fosse 4, morts dans des circonstances à peu près identiques ...
Partis de l'hôpital Sainte-Barbe à 12 h 30, onze cercueils sont alignés devant la façade de l'Hôtel de Ville. Manquent les corps des deux dernières victimes ayant succombé à l'hôpital la veille et l'avant-veille des funérailles.
Derrière les cercueils, les familles des victimes et celles des trieuses disparues. Des mineurs en tenue de travail la lampe cravatée de crêpe et les cinq trieuses, compagnes de travail des deux disparues et de celles en traitement à l'hôpital, forment une haie qui contient la foule. Une section de tirailleurs nord-africains rend les honneurs.
Pendant plus de deux heures, une foule recueillie défile devant les corps dans un silence poignant. D'humbles bouquets viennent grossir le parterre de couronnes et de fleurs s'étalant devant les cercueils.
Les personnalités arrivent et prennent place dans la tribune aménagée sur le perron de la mairie. Parmi elles
- MM. Phalempin, préfet du Pas-de-Calais, représentant le Gouvernement ; Pé, sous-préfet de Béthune ; Le Sénéchal, président du Conseil général du Pas-de-Calais ;
- MM. Mauvais, représentant le Comité Central du parti communiste français ; Ramette, membre du bureau politique ; Martel ;
- MM. Mollet, secrétaire général du parti socialiste ; Delabre, secrétaire de la Fédération départementale ; le Dr Schaffner, maire de Lens ;
- MM. Delaby, Pierrain, Fauquette, de la C.F.T.C. ;
- Des administrateurs et représentants des H.B.N.P.C. Communiqué du Gouvernement
« Le Gouvernement avait décidé de témoigner sa sollicitude aux familles des mineurs victimes du devoir, qui ont trouvé la mort dans la catastrophe d'Hénin-Liétard, en se faisant représenter aux obsèques par M. Robert Lacoste, ministre de l'Industrie et du Commerce.
Cette journée de deuil ayant été transformée en une journée de revendications politiques, le Gouvernement a estimé que M. Robert LACOSTE ne pouvait, dans ces conditions, y participer.
Le Gouvernement tient à redire aux familles si éprouvées de ces hommes courageux morts au Service de la France, son sentiment de reconnaissance et de grande sollicitude, en même temps qu'il met tout en oeuvre pour venir à leur secours ».
Des drapeaux rouges à profusion. Deux bannières illuminées : la Vierge noire des Polonais.
A 14 h 30, Mgr Perrin, évêque d'Arras, assisté de Mgr Chappe, et le clergé des paroisses environnantes, s'inclinent devant chaque cercueil. Puis, ensemble, ils entonnent un cantique, suivi de la lecture d'une lettre de Saint Paul. Mgr Perrin monte à la tribune ; il évoque la miséricorde divine, apporte les consolations de la Foi aux familles éprouvées, sa sympathie aux mineurs, et aux morts l'hommage et les prières de l'Eglise. Un chant : le « Libera me », et la bénédiction des corps.
Le doyen des aumôniers polonais adresse à son tour, dans leur langue, des paroles de réconfort à ses concitoyens.
La sonnerie « Aux morts » retentit, exécutée par la clique de l'Harmonie des Mines de Courrières. Soldats nord-africains, gendarmes, se figent au garde-à-vous. L'émotion étreint les cœur. Des femmes pleurent, sanglotent ; des hommes écrasent une larme au coin des yeux.
La cérémonie religieuse terminée, commence une longue série de discours
• M. GIOLAT, conseiller général, maire de Sallaumines, rappelle la douleur et la consternation des familles à l'annonce de la catastrophe.
• M. LAFFONT, au nom du Conseil d'Administration des H.B.N.P.C., assure les familles que toute l'aide sera apportée pour qu'elles ne soient pas dans le besoin et affirme que « la direction des bassins désire que l'enquête soit poussée jusqu'à son terme pour dégager les faits qui ont abouti à la catastrophe ».
• M. SAUTY, au nom de la C.F.T.C., partage la douleur des familles, rend hommage aux travailleurs du sous-sol, réclame toute la lumière sur les circonstances de la catastrophe, et adjure tous ceux qui ont la charge de veiller à la sécurité du mineur de mettre tout en oeuvre pour que pareil sinistre ne se reproduise plus.
• M. LEBLOND, délégué mineur, rappelle la catastrophe de 1906 (les mêmes causes profondes ont produit les mêmes effets ...), signale les rapports dans lesquels il présentait les dangers en courus par les mineurs, conclut à l'entière responsabilité de l'exploitant, demande l'élargissement des pouvoirs des délégués.
M. DUGUET, secrétaire de la Fédération nationale du Sous-sol.
• M. LECCEUR, ex-secrétaire d'Etat, président de la Fédération régionale des mineurs du Nord-Pas-de-Calais : la responsabilité du patron est nettement engagée, « on veut blanchir les coupables : on confie l'enquête aux amis ... Nous ne pouvons avoir confiance en la Direction qui mène cette enquête ... », « Nous vous faisons le serment, ainsi qu'à vos familles, de redoubler d'ardeur pour que les responsabilités soient établies et pour que ceux qui restent soient protégés. »
M. JAYAT, de la C.G.T.
M. le représentant de l'Ambassadeur de Pologne.
• M. PHALEMPIN, préfet, déclare notamment : « Plutôt que d'évoquer ici des responsabilités qui n'ont pas encore été établies, chacun doit se dévouer et s'unir pour éviter le retour de nouvelles catastrophes ».
« La Marseillaise » marque la fin de la cérémonie officielle.
Les trieuses emportent fleurs et couronnes ; des mineurs transportent les cercueils, à l'épaule, jusqu'aux deux chars qui attendent sur la route nationale.
Et le cortège de s'acheminer douloureusement sur cette route qui conduit au cimetière de Sallaumines, route qui a vu conduire tant de mineurs à leur dernière demeure.
Dans le silence et le recueillement, les cercueils sont descendus dans leur tombe respective. Les amis entourent de leur sympathie les familles éplorées. La foule s'écoule, lentement.
La foule, une foule innombrable : 60 000 ... 150 000 ... 200 000 personnes, ont rendu un dernier hommage aux victimes de la catastrophe de Sallaumines.
La veille des funérailles, des mots d'ordre de grève avaient été lancés à travers le bassin transformant le jour des obsèques en une journée de revendications politiques. Des mineurs « C.G.T. » distribuent un tract : « Hommage de la masse de la corporation minière aux nouvelles victimes du Gouvernement Patron ».
Ce jeudi 22 avril, l'ensemble des mineurs du Bassin (130 000), n'auraient pas travaillé : est-ce l'amorce d'une grève générale ?
Des cahiers de revendications sont déposés ; les mineurs réclament notamment
- le paiement des journées chômées à la suite de la catastrophe, - le paiement du salaire intégral pour les blessés, - l'extension des pouvoirs des délégués mineurs, - une augmentation des rations alimentaires,
- le non-retrait des tickets de rationnement supplémentaires aux familles des victimes,
- l'application d'un plan de constructions d'habitations pour le personnel.
Le vendredi matin, le travail reprend dans les mines.
Dimanche 2 mai. Dans le courant de l'après-midi, une nouvelle circule à travers les corons. Les corps des trois disparus sont retrouvés.
Un sauveteur a découvert en effet vers 11 heures, le corps d'Hélène, presque coupé en deux par l'explosion, à mi-hauteur du puits.
De là naît une certitude : les deux autres corps sont au fond du puits. Les recherches reprennent. Effroyable découverte : deux corps déchiquetés, mutilés. Gertrude est identifiée par les lambeaux d'un maillot rouge ; le P.G. allemand est décapité.
Les corps sont remontés et conduits à l'hôpital Sainte-Barbe.
Mercredi 5 mai, un nombre important de trieuses venues de tout le bassin minier, le voile bleu à la tête, les bras chargés de fleurs, conduisent Hélène et Gertrude à leur dernière demeure.
Après les allocutions du maire de Sallaumines et de deux représentants de la Fédération Régionale des mineurs C.G.T., le représentant du consul de Pologne s'incline devant les victimes.
Une trieuse de la fosse 4 prend la parole : c'est l'ultime adieu à Hélène Loboda et Gertrude Beyer.
Emouvantes funérailles des dernières trieuses, victimes d'une catastrophe minière.
« NEGLIGENCE CRIMINELLE de la direction des Houillères aux ordres de l'Etat Patron », titre « LIBERTE » du 21 avril 1948, veille des obsèques.
Les délégués mineurs sont élus par leurs camarades de travail pour faire respecter l'hygiène et la sécurité dans les mines. Ils ont à leur disposition un cahier sur lequel ils consignent leurs observations et en marge desquelles les ingénieurs apportent leur réponse.
On ne connaît pas la cause de la catastrophe. Mais une chose apparaît certaine, il s'agit d'un coup de poussières.
Qu'est-il écrit sur le cahier de rapport du délégué de la fosse 4 ? D'octobre 1947 à avril 1948, 28 rapports signalent des accumulations de poussières. qui rendent l'atmosphère irrespirable. On peut y remédier par l'arrosage ; mais ...
Un exemple, le rapport 123, du 30 mars 1948
« Je me demande pourquoi maintenant, l'on a interdit l'arrosage au bec de la taille et des convoyeurs, pourtant il y avait là une poussière telle qu'on n'y voit plus clair ».
Réponse de l'exploitant
« Nos pulvérisateurs actuels débitaient trop d'eau, mouillant anormalement les charbons, provoquant des accidents dans la marche des lavoirs ; un pistolet à brouillard a été installé à la tête de la trémie pour essai ».
Les rapports du délégué mineur sont un réquisitoire accablant contre les Houillères. La politique charbonnière est mise en cause : produire au prix de revient le plus bas possible ne peut se faire qu'aux dépens de la santé et de la sécurité des mineurs.
En 1906, on n'avait pas tenu compte des observations du délégué mineur Simon, dit Ricq. Quelques jours plus tard, ce fut la catastrophe qui ravagea les fosses 2 de Billy-Montigny, 3 de Méricourt et 4 de Sallaumines : 1 099 Morts.
Depuis, dans les galeries, des planches d'arrêt-barrage, dites Taffanels, chargées de poussières stériles, ont été installées au toit. Le souffle d'un coup de grisou fait retourner ces planches ; le mélange des poussières stériles et de charbon empêche la propagation de l'explosion. Ce qui s'est produit à la fosse 4 les chantiers du fond sont restés intacts.
Mais il y a eu un coup de poussières dans le puits.
Le 25 avril, dans une déclaration, la direction des H.B.N.P.C. fait savoir que les causes de la catastrophe demeurent inconnues. 100 mètres du puits ont été explorés, il en reste encore 300 pour tenter de résoudre le problème. « L'explosion ne provenait pas des chantiers du fond. Le puits s'est comporté comme le tube d'un canon ouvert aux deux extrémités. La flamme a soufflé dans les galeries. Mais elle provenait du puits. L'incendie du criblage s'est-il déclaré avant ou après ? On ne le sait ». Par ailleurs, il n'y avait pas d'explosifs dans le voisinage du puits. L'accident est sans rapport avec les travaux du fond et « les constatations qui ont pu être faites auparavant par les délégués mineurs ne révèlent aucune relation de cause à effet entre les travaux et le triste événement que nous déplorons ». En conclusion, la Direction demande la création d'une commission d'enquête pour « faire toute la lumière sur la catastrophe et éviter le retour d'un semblable accident ».
La catastrophe, sans précédent, apparaît inexplicable.
Les mineurs et leurs représentants veulent également une commission d'enquête, mais non d'une commission composée de représentants de l'Etat-Patron. Ils veulent une commission paritaire. Ils n'ont pas confiance en l'Etat-Patron.
Quelque chose heurte l'esprit. L'Etat a imposé les délégués au temps des compagnies privées. Avec les nationalisations, le travail n'a plus devant lui les seigneurs de la mine. Les communistes dénoncent les crimes de l'« Etat-Patron ». Le parti de Maurice Thorez condamne-t-il déjà les nationalisations pour en revenir à un système corporatif « la mine aux mineurs » ? C'est ce qui semble ressortir de la lecture d'un article paru dans « Combat » du 24 avril 1948 sous la signature de Jean Texcier.
L'examen du puits a permis de constater que
les câbles téléphoniques ont été retrouvés en bon état, les câbles électriques à 3 000 volts n'ont pas souffert,
aucune trace de court-circuit n'a pu être relevée dans le criblage,
- la canalisation d'air comprimé de 250 mm de diamètre avait éclaté dans le puits en 22 points différents échelonnés sur plus de 300 mètres,
l'un des compresseurs porte les traces d'un coup de feu ; on a relevé, dans le voisinage, des dépôts de coke léger, dépôts de produits de distillation d'huile lourde.
L'air comprimé se trouvait chargé de matières combustibles en proportion suffisante pour constituer un mélange détonant qui a provoqué la destruction de la canalisation d'air, d'où le soulèvement des poussières déposées sur les surfaces internes du puits et l'inflammation du nuage de poussières. Mais comment s'est produite l'explosion ? .. .
Le mécanicien des compresseurs avait prévenu que, depuis huit jours, la vidange d'huile ne se faisait plus. La canalisation d'air comprimé est vieille et « débitait » plus qu'au moment de son installation. Par suite de la modification des procédés de fabrication, les huiles de graissage utilisées à l'origine, pendant et après la guerre ne sont pas les mêmes.
On a dit et écrit qu'aucun indice d'incurie n'ayant été relevé, aucun service des Houillères ne pouvait être mis en cause. « La cause de la catastrophe était imprévisible ».
J'habitais alors Grenay et, depuis le 2 février 1948, j'étais moniteur de formation générale, en stage, au centre d'apprentissage minier situé au stade Paul-Guerre de Billy-Montigny.
Du train qui me ramenait chez moi, je revois encore l'énorme panache de fumée noire formé par les poussières s'élevant au-dessus de la fosse. Et les voyageurs de s'interroger.
Je venais de perdre mon père. Pas de radio à la maison. Je n'ai appris la catastrophe que le lendemain par mes collègues de travail et des galibots qui travaillaient à cette fosse : mon premier contact avec les drames de la mine.
L'ingénieur en chef de la fosse 4 est devenu par la suite chef du Service de la Formation professionnelle du Groupe d'Hénin-Liétard dont je faisais partie. Il supervisait les centres d'apprentissage minier. Combien ont souffert de son comporte ment ! La mentalité d'un centre d'apprentissage n'est pas celle d'une fosse.
Sous son « règne », je suis descendu à la fosse 4 de Sallaumines. Une fosse poussiéreuse comme jamais je n'en ai rencontrée. Une atmosphère suffocante, irrespirable.
Comme si les cercueils étaient encore là, inclinons-nous au souvenir
- de nos jeunes trieuses âgées de 19 ans : BEYER Gertrude et LOBODA Hélène, toutes deux polonaises ;
- des deux employés du jour : BIGOTTE Maurice (38 ans), MILO Oscar (54 ans) ;
- des mineurs français :
- BRISSE Marcel (39 ans),
- CAPILLON René (22 ans),
- DEMICHELIS Baptiste (20 ans),
- QUINCHON René (47 ans),
- VASSEUR René (33 ans) ;
- des mineurs polonais :
- KACZMAREK Jean (16 ans),
- WYSOCKI Simon (38 ans) ;
- du mineur portugais : FEURRERA Armand (30 ans) ;
- des prisonniers de guerre allemands transformés en travailleurs libres : HIERL Georges (25 ans), GUEUER Hermann (23 ans), RAK Hubert (25 ans), SCHAAF Helmut (39 ans) ; tombés au Champ d'Honneur du Travail.
![]() HAUT
HAUT
![]() ACCUEIL
ACCUEIL
 Télécharger
le document
Télécharger
le document
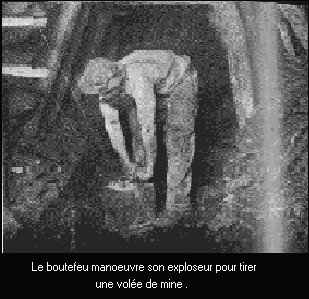 RETOUR
CATASTROPHES DANS LES MINES
RETOUR
CATASTROPHES DANS LES MINES