Un incendie s'était déclaré le jeudi 15 mars dans un treuil donnant sur la voie Joséphine, à 800 mètres environ du puits 2. Coûte que coûte il fallait maîtriser le feu si l'on voulait poursuivre le déblaiement des voies et la remonte des cadavres.
Et, pour parer au plus pressé, l'inspecteur Delafond, dans un premier temps, avait fait barrer les bowettes des étages 340 et 306 avec l'espoir que, faute d'air, le feu aurait été étouffé.
Par suite des dangers que présente cet incendie, il est question de transférer de Billy-Montigny à la fosse 4 de Sallaumines le quartier général des opérations de sauvetage. Le système d'aération serait alors renversé ; des sapeurs pompiers descendraient en éclaireurs dans la mine par le puits 11.
Mais n'y avait-il pas lieu de craindre que là aussi les sauveteurs ne soient exposés aux mêmes dangers qu'à la fosse 2: émanations cadavériques, gaz provenant de l'incendie dans la veine Cécile proche du puits 3 ?
Les vendredi 16 et samedi 17 mars, Delafond consulte des spécialistes. On hésite, on tergiverse.
Ce 17 mars, la commission médicale est réunie à Billy-Montigny où, dans l'après-midi, arrive Clémenceau. Chacun donne son avis. Une décision est prise.
Le dimanche 18 mars paraît le communiqué suivant
« Les conditions d'aérage des quartiers des fosses 4 et 11 étant demeurées médiocres et ne paraissant offrir qu'une sécurité insuffisante, on renonce au projet de reprise momentanée de la fosse no 11 et on attend qu'on puisse rentrer dans les travaux du puits no 2. »
« L'incendie, qui avait arrêté les travaux de sauvetage, paraissant être en grande partie étouffé par l'action des barrages, on compte pouvoir bientôt effectuer la rentrée des sauveteurs dans la mine. »
« On prépare l'installation d'une conduite d'eau souterraine et on attaquera, au moyen de projection d'eau, le feu qui se rallumera probablement lorsqu'on arrivera à proximité de l'air pur . »
Lundi 19 mars. Décision : attaque du feu à partir de l'étage 340 de la fosse 2. Les barrages sont percés et munis de solides portes en fer, à l'exception bien entendu du barrage dressé à l'étage 306.
On recrute des mineurs robustes, on les entraîne à la lutte contre le feu. Ils seconderont les pompiers de Gelsenkirchen et ceux de Paris. En travers de la galerie seront tendues des toiles mouillées : abri derrière lequel se tiendront les sauveteurs dans l'attente de relayer leurs camarades sur la ligne du feu.
Vers 16 heures, Delafond, Bar, Petitjean et l'ingénieur en chef des mines d'Ostricourt, spécialiste des incendies dans les mines, descendent par le puits 2, inspectent les travaux, font ouvrir les portes aménagées dans les barrages.
Après être remontés au jour et s'être assurés qu'il n'y avait plus personne au fond, un violent courant d'air est établi. Le but? Chasser les gaz provenant de la combustion du charbon, une opération extrêmement dangereuse, car elle risquait de produire une nouvelle explosion. Il n'en fut rien, heureusement.
Vers 19 heures, ingénieurs et sauveteurs redescendent. Delafond est confiant. On amènera de l'eau au fond ; des boiseurs remettront en état les galeries et bowettes relevant de l'accrochage 340 ; on descendra des cercueils : la mise en bière des victimes s'effectuera au fur et à mesure de leur découverte.
Mardi 20 mars. Delafond est à Paris. Léon, rétabli, a repris son service.
Au cours de la nuit, 300 mètres de canalisation d'eau ont été posés ; les travaux de boisage effectués permettent de s'approcher jusqu'à 8 mètres du feu ; une ligne téléphonique est installée. Bientôt, on sera en mesure d'attaquer le foyer d'incendie.
Les sauveteurs allemands sont invités entre-temps à une réception organisée en leur honneur à Paris par l'Université populaire du Faubourg Saint-Antoine, réception à l'issue de laquelle est prévue la présentation du -Vieil Heidelberg ..
Ils désirent rester à côté de leurs camarades français pour combattre le feu. La réception est reportée.
Sauveteurs allemands et français travaillent la main dans la main et dans un tel esprit de camaraderie qu'entre eux c'est devenu « à toi, à moi ».
Mercredi 21 mars, 4 heures : c'est l'attaque du feu.
Deux heures plus tard, les sauveteurs ont déjà gagné 4 mètres ! L'espoir règne : on espère circonscrire rapidement l'incendie.
Peu à peu, cependant, des difficultés surgissent : le toit reste rougeoyant, la pression d'eau est insuffisante pour combattre le brasier. L'eau arrive en effet au fond après une chute verticale de 340 mètres dans le puits, chute qu'il faut amortir à l'aide de bâches de réception installées à divers étages pour éviter les dégradations que ne manquerait pas d'occasionner la pression d'eau résultant d'une chute libre. Un certain pessimisme commence à régner : qui peut préjuger en outre de l'ampleur du sinistre?
Avec acharnement cependant, les techniciens s'emploient à remédier à la situation ; leurs efforts sont couronnés de succès ! Bien mieux, ils installent une seconde canalisation d'eau qui permettra non seulement de combattre le feu, mais aussi de «rafraîchir» quelque peu l'atmosphère étouffante qui règne aux abords de la zone embrasée.
Entre-temps, au cours de la journée, arrive d'Allemagne le docteur Bruns, Directeur de l'Institut d'Hygiène et de Bactériologie à Gelsenkirchen. De quelle mission est-il chargé ? .. .
La recherche et le ramassage des morts incombent aux mineurs français qui opèrent sous le contrôle du Professeur Calmette. Avant de les retirer des décombres, ils déversent des seaux de lait de chaux sur les cadavres putréfiés des hommes et des chevaux. Les restes humains sont immédiatement mis dans les cercueils. C'en est fini de la reconnaissance des corps par les parents.
Quant aux sauveteurs allemands, ils sont exclusivement occupés à lutter contre l'incendie. Mais, pour gagner leur champ d'action, il leur faut franchir des zones infestées de mouches, moustiques s'attaquant aux cadavres, et dont ils avaient signalé la présence. Ces sauveteurs représentant l'élite du corps des sapeurs-pompiers de la mine, on craignit, pour eux, en Allemagne, la peste, le typhus. D'où l'arrivée du docteur Bruns venu spécialement prendre les mesures de prévention nécessaires contre tout danger d'épidémie.
Sur le plan sanitaire, le professeur Calmette est le seul maître. La mission de Bruns ne peut donc que se limiter à instruire les mineurs allemands de la meilleure façon de se protéger du danger représenté par les corps putréfiés, s'ils sont amenés à en manipuler. Les instructions sont nettes, précises et fermes.
Les corps doivent être ramassés avec des gants de caoutchouc et déposés dans des draps imprégnés de sublimé. Après la remonte, chacun doit se nettoyer les mains avec des produits antiseptiques. Les moindres blessures, les moindres piqûres doivent être signalées, immédiatement nettoyées et recouvertes d'un emplâtre. Dès l'apparition de violentes douleurs - signes d'empoisonnement - un médecin doit être mandé d'urgence.
Dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, Bruns, par précaution, avait emporté du sublimé, du phénol, de la formaline ; et même des produits chimiques destinés à atténuer l'odeur pestilentielle émanant des cadavres. Sa présence à Billy-Montigny était un apaisement pour la Société Hibernia. Grâce à lui, aucun sauveteur allemand ne fut malade. Et indirectement les Français profitèrent de ses leçons.
A la suite de son passage à la fosse 2, le docteur Bruns aurait présenté un rapport resté confidentiel.
Dans la soirée de mercredi, Delafond arrive de Paris pour se rendre compte de l'avancement des travaux. Les moyens mis en œuvre doivent permettre de venir à bout de l'incendie. En cas d'échec, les barrages seraient définitivement fermés ; une ouverture serait pratiquée au-dessus du foyer d'incendie, ouverture dans laquelle serait injectée l'eau additionnée d'argile ; le feu serait ainsi étouffé par colmatage.
La lutte contre l'incendie se poursuit donc aussi activement que possible.
En ce matin du jeudi 22 mars, le bilan est le suivant 12 mètres de galerie ont été conquis sur le feu depuis le début des opérations ; il reste 6 à 7 mètres de brasier à éteindre avant d'arriver au sommet du montage, soit 10 à 12 heures d'efforts. Là, on tentera de déterminer l'importance du feu dans les dépilages. De nouveau, règne l'espoir de maîtriser l'incendie assez rapidement.
Le communiqué publié dans la soirée laisse cependant planer un doute. Le matin, on pensait arriver au sommet du montage après 12 heures d'efforts au maximum ; or les sauveteurs sont loin d'y être !
« Nous poursuivons énergiquement la lutte contre le feu. Nous sommes parvenus à 72 mètres du pied du montage où s'est déclaré l'incendie, et devons encore conquérir six mètres pour parvenir au sommet ».
« Les parties conquises sont, aussitôt que possible, solidement boisées »
Un communiqué laconique qui laisse entrevoir les difficultés rencontrées par les sauveteurs.
Voir un incendie dans une mine, c'est l'occasion de vivre un moment exceptionnel. Et, pour les journalistes qui vont et viennent entre Lens et Billy-Montigny, c'est l'article de presse hors ligne.
Il est interdit à toute personne étrangère à la mine de descendre? Qu'importe ! Dans des circonstances exceptionnelles, n'est-il pas facile de se mettre de connivence avec quelqu'un? C'est ainsi que certains descendent incognito.
Qui peut en effet deviner un journaliste derrière des habits de mineur?
D'autres, plus sages, essaient de trouver un responsable des opérations susceptible de les prendre en charge.
Ce vendredi 23 mars après-midi, Léon Gobert du « GRAND ECHO » et Armand Villette, rédacteur au journal « LE GAULOIS», attendent dans le bureau de permanence des ingénieurs. II est 14 h 30. Weiss, ingénieur des mines à Paris, adjoint provisoirement à Léon par décision du ministre des Travaux publics en date du 21 mars, s'apprête à faire une tournée d'inspection avec Anglès d'Auriac également ingénieur du corps des mines.
Ceux-ci acceptent la compagnie des journalistes. Mais chacun à ses risques et périls.
Travestis en mineurs, joignons-nous à eux. Lampisterie, moulinage, «mise en cage». La descente vertigineuse dans une position plus ou moins confortable. Le temps de découvrir à la lueur des lampes que les parois du puits ruissellent d'eau, le temps de ressentir que cette eau tombe en gouttelettes sur nos vêtements et nous sommes à l'étage 340. La cage s'arrête.
Direction : bowette sud. Une porte d'aérage en empêche l'accès. Un mineur la tire avec peine ; l'air s'engouffre et nous frappe violemment le visage.
En route ! La bowette, d'abord large, se rétrécit, ravagée en partie par l'explosion ; les fers de soutènement sont tordus, des berlines sont démolies, écrasées.
Nous quittons la bowette et empruntons un chemin ouvert dans une voie éboulée. Courbés, nous marchons à la queue leu leu. Des étais sont déjà cassés ; il faudra les remplacer ... Soudain une odeur insoutenable de chair putréfiée : dans les éboulis, un cadavre, celui sans doute d'un conducteur de berlines ... Plus loin, un autre cadavre, celui d'un cheval qu'on n'a pu déplacer ; la voie avait dû être déviée sur la droite et le cadavre recouvert de pierres, de sacs de désinfectant ... Un peu plus loin, un énorme caillou s'est détaché du toit, la voie est quasi bouchée : à plat ventre, la lampe portée à bout de bras en avant, nous rampons pendant quelques mètres ... Et soudain, à nos pieds, le montage dans lequel l'incendie s'est déclaré. Avec, tout au fond, des points lumineux mouvants.
Le cœur battant, nous avançons avec peine, l'échine courbée, au milieu d'une chaleur intense, dans un boyau d'un mètre de large sur 40 cm de haut. Au-dessus de nos têtes, de gros cailloux prêts à tomber malgré un boisage neuf, renforcé. Le moindre coup de terrain et c'est fini ! Weiss en tête, Anglès d'Auriac par derrière, impossible de rebrousser chemin. Le sol est encore chaud et, sous les chaussures, craquelle du coke ...
Nous sommes maintenant à une douzaine de mètres du feu, les yeux piquants, le souffle coupé, avec d'autres hommes le torse nu, le visage et le tronc engluantés d'une bouillie noire : allemands, parisiens, mineurs se confondent sous un même masque.
Sur le front, une lueur claire. Face à face : le charbon incandescent et un pompier, la lance braquée sur un point du brasier ; un homme, un être humain silencieux, stoïque, suffoqué. L'eau frappe d'un jet puissant le feu qui résiste, crépite. L'eau bouillonne, recule dans un nuage de vapeur qu'un courant d'air emporte.
Proche de lui, un autre pompier arrose la paroi. L'eau coule sur le sol. Partout de la vapeur formant un écran derrière lequel on perçoit les lueurs de flammèches qui se meuvent en un dernier sursaut.
Un signe. Deux hommes en retrait s'avancent. Ceux du front reviennent noyés, épuisés, incapables de parler. Impossible de tenir plus de six minutes. L'atmosphère est surchauffée 50 degrés. Les corps se déshydratent, le sang afflue au cerveau, les oreilles bourdonnent.
L'équipe de relais attaque le feu à son tour. Un morceau de houille s'est éteint. On déplace la lance. Un pompier fonce au milieu de la fumée sur le sol brûlant. A coups de pic il détache des croûtes de charbon, creuse une sorte d'entonnoir dans lequel de nouveau l'eau sera projetée.
Des efforts disproportionnés, incommensurables pour faire reculer le feu de quelques centimètres. A plus de 300 mètres sous terre !
Nous sommes là, à la merci d'un éboulement, à la merci d'un retour d'air qui ramènerait sur nous les gaz, les flammes : grillés sur le champ ! Nous ne disons mot. De peur d'éveiller la Mort.
Alors qu'à côté de nous Weiss s'entretient tout naturellement avec les mineurs sur l'état d'avancement des travaux, chacun ayant malgré tout un oeil sur les hommes « à front ».
Le point de la situation étant fait, il faut quitter les lieux et laisser le champ libre aux combattants du feu. Anglès d'Auriac en profite pour nous préciser d'un ton calme
« Si vous étiez venus, il y a quelques jours, vous auriez vu tout le montage où vous êtes, incandescent, formant comme une sorte de four rouge, d'où surgissaient d'un côté quelques flammes. Le spectacle était curieux. Nous avons gagné une trentaine de mètres. Quand on aura déblayé l'éboulement et enlevé le charbon, on pourra gagner les cinq à six mètres qui restent pour atteindre le sommet. »
Nous quittons un enfer, le cœur mêlé de joie et de tristesse, avec un sentiment indéfinissable.
On va essayer d'attaquer le feu à revers? Une idée à creuser, et peut-être à exploiter si comme on le pense le feu est peu étendu. L'examen de la question est prévu dans la tournée de Weiss.
Passant par un autre montage, nous aboutissons à l'étage supérieur dans une voie déblayée où se trouve justement l'ingénieur Fournier.
Celui-ci fait part de ses observations à Weiss. Ensemble, ils arrêtent les mesures à prendre.
Avant de partir, Weiss veut se rendre compte de la situation. Nous avançons vers la zone de feu. Une odeur de charbon brûlant, de bois fumant nous saisit à la gorge. De plus en plus forte. De plus en plus âcre.
Pas question d'aller plus loin :.il y a danger d'asphyxie. Sur l'ordre de Weiss, nous nous arrangeons pour dissimuler la lueur de nos lampes. C'est l'obscurité complète. Aucun point lumineux du côté de la zone de feu. Weiss est rassuré. Mais il interdit formellement à Fournier de s'aventurer plus avant sans être accompagné de sauveteurs munis de leur appareil respiratoire.
La visite est maintenant terminée. Nous retournons à l'accrochage. Des ouvriers installent la conduite d'eau destinée à cerner l'incendie.
Nous atteignons ensuite une galerie dont le boisage a été refait et le roulage remis en état. Elle relie le puits 3 au puits 2. C'est par cette voie qu'on aurait pu procéder à l'enlèvement des morts au 3 s'il n'y avait pas cet incendie qui constitue un danger permanent. En attendant, des ouvriers consolident, améliorent la circulation de cette grande artère souterraine.
De la voie 312, nous descendons à l'étage 340, courbés ou debout ; heurtant un bois de la tête ou trébuchant dans les rails; pataugeant dans la boue ou traversant des mares d'eau.
Nous sommes rompus, trempés ... Pauvres loques humaines ! ...
Voici l'écurie ? Nous sommes proches de l'accrochage. La porte d'aérage. Une bouffée d'air frais bienfaisante l'accrochage ! La remonte. Le jour. Ouf !
Nous avons visité la mine en feu, nous la quittons heureux d'en être sortis à bon compte ! admiratifs devant ces hommes qui s'acharnent à vaincre l'incendie au mépris d'un danger permanent ! fiers d'avoir vécu quelques instants d'un spectacle inoubliable, inimaginable
Des parois incandescentes léchées par des flammes une vision d'enfer. Des êtres humains qui se battent avec le feu dans une atmosphère d'étuve : une vision dantesque.
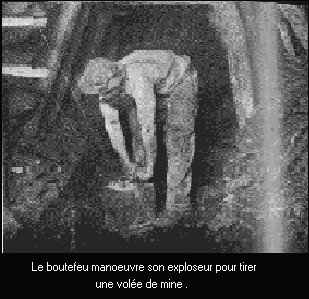 RETOUR
BILLY AU COEUR DE LA CATASTROPHE DE COURRIERES
RETOUR
BILLY AU COEUR DE LA CATASTROPHE DE COURRIERES